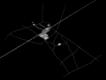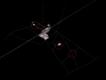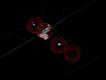Châteauroux
Demain, la ville
Châteauroux, un problème d’urbanité : il s’agit de la conception qu’ont de la ville en général les acteurs publics et les habitants. C’est-à-dire de la ville comme lieu de vie, comme « milieu naturel des sociétés humaines ». Châteauroux se présente comme « plus qu’une ville et tellement mieux qu’une métropole » et elle tend à fonctionner comme une fabrique, scindée en unités de productions autonomes — les quartiers. Comme toute entreprise, elle cherche à faire des bénéfices et compte pour cela sur des investissements extérieurs, comme l’installation prévue d’une zone franche franco-chinoise. Cette posture n’est pas durable et va devoir céder la place à l’appropriation d’une véritable urbanité, fondée sur la coprésence (et pas sur la séparation), sur la diversité (et pas sur l’homogénéité), sur une centralité forte (et pas sur la multiplication de quartiers) et sur une croissance propre à la ville par son attractivité et sa spécificité (et pas sur un moteur économique externe). C’est à ces conditions que Châteauroux pourra se développer comme ville à part entière et trouver sa place dans le réseau urbain français de demain.
État des lieux en 2010
Urbanité relative faible
Châteauroux n’a pas l’intensité urbaine qu’elle devrait avoir compte tenu de sa taille en population. En comparaison, la ville d’Évreux, également partenaire de l’exercice et de taille équivalente, présente un niveau d’urbanité nettement supérieur à celui de Châteauroux, tant en termes d’offre urbaine que d’ambiance et de dynamisme.
Il ne s’agit pas là d’une question économique, car Évreux connaît au contraire une profonde crise de son tissu industriel, ayant entraîné un chômage important. Malgré cette crise, la ville a atteint un niveau d’urbanité suffisamment élevé pour que la disparition de l’activité économique dominante n’emporte pas la ville entière avec elle et ne provoque pas la stagnation de tout le tissu urbain.
Le manque de diversité de l’offre commerciale, l’absence de services rares ou de grande envergure, l’absence de vie urbaine nocturne et sa faiblesse durant les jours fériés, sont autant de caractéristiques illustrant les lacunes urbaines de la ville et expliquant son manque d’attractivité.
Refus du statut de métropole
L’agglomération castelroussine, dont Châteauroux est la ville principale, a choisi de mettre en avant son bas niveau urbain, en refusant le statut de ville et de métropole. Le pari marketing est visiblement celui de se démarquer de la principale métropole toute proche, Paris, pour attirer les Parisiens censés fuir le bruit, la pollution, le stress, les longs trajets et les coûts très élevés de la capitale et de sa proche banlieue.
Le problème que pose une telle démarche est que l’absence des inconvénients de la ville s’accompagne le plus souvent de l’absence des avantages aussi, comme c’est le cas à Châteauroux. En effet, la densité urbaine d’une métropole est associée à une grande diversité d’offre, de populations, d’activités, d’ambiances, d’opportunités économiques et sociales, qui ne sont pas présentes au même niveau dans une ville de rang moindre.
De plus, dans le contexte actuel de la France et plus généralement du monde, la dynamique dominante est celle d’une urbanisation généralisée, privilégiant les métropoles au détriment des petites et moyennes villes. Il semble donc imprudent pour l’agglomération castelroussine de prendre la direction inverse, plutôt que d’essayer de se rattacher aux franges de la métropole parisienne en augmentant autant que possible son niveau d’urbanité relative.
Une ville qui ne s’envisage pas comme telle
Châteauroux semble s’envisager plutôt comme une entreprise divisée en zone fonctionnelles que comme une ville organisée autour d’un centre et de quartiers périphériques. Une entreprise qui aurait comme principal objectif de faire du bénéfice et de trouver des clients et qui se devrait de conserver une répartition stricte et étanche entre ses différents espaces pour garantir le meilleur rendement possible.
Ce qui est à l’inverse du fonctionnement urbain, dans lequel les liens et les relations comptent plus que les zonages et pour lequel l’activité productive est une facette de moins en moins indispensable. En effet, un nombre croissant de villes reposent aujourd’hui sur une économie résidentielle, qui tient à la présence des habitants et à leur pouvoir d’achat (y compris pour le paiement des impôts locaux) plutôt qu’à celle d’une industrie.
Une ville de quartiers
Châteauroux est caractérisée par une surreprésentation des logiques de quartier (espace de proximité, plus homogène en termes d’offre et de populations, privilégiant les liens d’appartenance), par rapport aux autres logiques urbaines que sont la centralité (un espace concentrant la plus forte diversité d’offre et de populations de la ville) et les espaces publics (ouvert à tous, mixtes et non programmés).
La ville est donc composée de plusieurs modules relativement fermés sur eux-mêmes et fortement distincts, qui peinent à entrer en relation étant donnée l’absence d’un espace véritablement central permettant de drainer les différentes populations en un même lieu et d’espaces publics facilitant leur rencontre.
De plus, le faible niveau d’urbanité de chaque quartier et l’absence de différenciations fortes entre des espaces qui relèvent finalement des mêmes logiques générales, nuit à l’identité de la ville et à sa lisibilité. Aucun espace fort ne se démarque des autres et ne peut donc assurer l’attractivité de la ville vis-à-vis de l’extérieur, ni contribuer à fédérer les habitants de l’intérieur.
Stratégie de containment
Dans une ville comme Châteauroux, le statut des différents quartiers semble contribuer à maintenir le statu quo, contre les éventuels processus d’urbanisation et donc de brassage qui pourraient traverser l’espace urbain. Ainsi, les quartiers Saint-Jean et Saint-Jacques, classés ZUS, sont clairement identifiés et institués comme quartiers habités par des populations à faibles revenus et d’origine étrangère. De même, la future installation de populations chinoises est prévue en dehors de la ville, sur un espace bien délimité.
La gratuité des transports publics n’est pas suffisante pour compenser cette assignation spécifique à chaque quartier et pour rompre l’ordre institué. En effet, ils assurent une circulation accessible à tous mais ils ne peuvent, à eux seuls, combler le fossé social et culturel existant entre les quartiers. Ce qui se traduit d’ailleurs par une tendance des jeunes habitants des quartiers ZUS à rester dans les bus et à les transformer en espaces publics de rencontre et de loisir, plutôt que de les utiliser pour les conduire d’un point à l’autre de la ville.
Le centre n’est qu’un quartier riche
Le centre historique est identifié par les habitants comme un autre quartier de la ville, caractérisé par un niveau de richesse plus élevé. De ce fait, il n’est pas accessible à toute la population castelroussine, qui n’a pas forcément les moyens de s’offrir les articles en vente dans les commerces, les menus proposés dans les restaurants ou encore les logements disponibles.
Les habitants ont d’ailleurs souligné que le centre-ville est surtout composé d’espaces commerciaux et qu’il est difficile d’y passer du temps sans être dans l’obligation de consommer. Une caractéristique qui réduit d’autant plus l’accès au centre pour la partie de la population dotée des revenus les plus faibles.
Dans ce contexte, le centre historique n’est pas en mesure de jouer le rôle de brassage qu’est censé assurer un centre-ville, pour permettre aux populations des différents quartiers de se retrouver dans un lieu commun. Les dynamiques d’identification collective à l’ensemble urbain castelroussin en sont réduites d’autant et les processus identitaires se déploient plutôt à l’échelle des quartiers.
Inversion de la centralité
Le repli sur les quartiers de la construction des appartenances entraîne progressivement une inversion de la centralité vers les quartiers les plus peuplés et vers ceux qui ont l’empreinte identitaire la plus prononcée : les ZUS Saint-Jean et Saint-Jacques, habitées en grande partie par des populations d’origine étrangère.
Pour les habitants de ces quartiers, Saint-Jean et Saint-Jacques, doté d’un marché très attractif, font figurent de centre au même titre, voire davantage, que le centre historique. Ils présentent d’ailleurs une certaine attractivité aussi pour le reste de la population castelroussine, qui fréquente le marché et la coopérative de produits biologiques. Et ce d’autant plus que e centre-ville dispose de peu d’atouts, tant du point de vue des commerces, peu diversifiés, que de celui des services ou tout simplement de l’ambiance urbaine. On peut d’ailleurs noter que l’équipement culturel majeur de la ville que constitue la scène du Tarmac, a été placé en périphérie éloignée du centre historique, ce qui ne fait que confirmer sa faiblesse.
Preuve supplémentaire, si besoin en est, que la présence d’un patrimoine historique (lacis de rues anciennes par exemple) et le fait d’avoir été le centre-ville dans le passé ne sont pas du tout des conditions suffisantes pour remplir le rôle de centre aujourd’hui, même dans une ville moyenne comme Châteauroux. La centralité doit se construire sur de nouveaux critères, privilégiant notamment la densité des équipements, leur diversité et la présence d’espaces publics de qualité.
Ville coupée en deux
Châteauroux présente également la caractéristique d’être divisée en deux sous-villes, quasiment autonomes, entre lesquelles s’étend une sorte de no man’s land à très faible urbanité. La coupure est même d’ordre physique, puisque les rails de chemin de fer séparent nettement les deux espaces, avec pour seule articulation une passerelle vouée à destruction dans un avenir proche.
Bien que dotée d’une gare, reliant la ville à la capitale en deux heures, et d’un vaste centre commercial, cette zone ne joue pas le rôle d’espace intermédiaire entre le centre historique et ses périphéries (Saint-Jean et Saint-Jacques notamment) mais celui de vide répulsif, renforçant la tendance des deux sous-villes à se tourner le dos et handicapant la possibilité pour Châteauroux de fonctionner comme une entité globale et unie.
Économie de comptoir
Châteauroux appuie sa croissance sur des bases économiques externes, qui sont indépendantes du dynamisme urbain de la ville et qui ne contribuent pas à la développer. Il s’agit de sources de revenu indépendantes qui ont l’avantage de procurer des emplois et/ou des bénéficies à la ville, mais qui restent fragiles dans la mesure où elles pourraient s’installer ailleurs sans difficulté.
Châteauroux dispose d’une base économique publique, à travers la présence des services publics et de l’administration, ainsi que d’une base économique avec la future mise en place de la zone franche franco-chinoise. Son moteur économique n’est donc pas intrinsèque, en liaison avec le fonctionnement de la ville elle-même, ce qui représente à la fois un risque et une pression permanente pour trouver une nouvelle ressource à exploiter, au détriment d’une stratégie de développement urbain autonome.
Cette posture « coloniale » contribue en outre à accentuer la dissociation morphologique, fonctionnelle et sociale entre le centre-ville et les quartiers périphériques, qui se situent bien plus loin que la réalité kilométrique. Le premier, fonctionnant comme un comptoir et les seconds, jouant le rôle de colonies, sont séparés par un océan symbolique, faisant obstacle à tout développement cohérent de la ville.
Toujours à la périphérie
Plutôt que de fonctionner comme un centre, qui impulse le développement et rayonne sur sa périphérie, Châteauroux est toujours en relation de dépendance avec son environnement proche. Au commencement, elle dépendait des zones de production agricole autour, en tant que bourg rural servant de relais commercial. Puis ce fut au tour des banlieues industrielles de lui fournir des ressources, en activité et en consommateurs. Ensuite, elle s’est rattachée à la base de l’OTAN, qui lui procurait à la fois des revenus, des emplois et qui contribuait à animer la ville. Désormais, elle compte sur l’installation de la zone franche franco-chinoises pour jouer un rôle équivalent. L’aéroport de fret et de logistique joue aussi ponctuellement ce rôle de ressource externe, que la ville souhaite développer davantage.
Ces processus successifs d’exploitation des ressources extérieures n’ont pas permis à la ville de se développer comme telle et d’assumer son rôle de centre. Elle est devenue de plus en plus dépendante de ses périphéries productives, fragilisant ainsi fortement sa position dans le système urbain régional et national. Surtout, une telle posture ne semble pas durable dans le contexte urbain actuel, caractérisé par une hyper concurrence des territoires pour l’attractivité des activités productives et par une mobilité exacerbée de ces dernières. À ce rythme, Châteauroux risque de devoir chercher une nouvelle bouée de sauvetage tous les deux ans et se retrouver rapidement sans ressources et sans perspectives de développement.
Vision prospective pour 2040
Une ville, et plus une unité de production
Châteauroux aura quitté son statut et sa posture d’unité de production, pour devenir une ville à part entière. Son moteur de dynamisme et d’attractivité sera intrinsèque et elle aura développé une économie résidentielle, dans laquelle les habitants urbains sont la principale source de revenus de la ville, par le simple fait d’y vivre au quotidien et d’y payer des impôts, sans forcément y travailler.
En passant d’un espace productif sous perfusion à un espace urbain efficace, Châteauroux sera rentrée dans un réseau urbain lui permettant de bénéficier des interactions avec les voisins. Notamment, elle aura pu développer son économie résidentielle en s’appuyant sur la proximité d’un espace de production fort et riche, celui de la région parisienne, qui alimentera la ville en actifs cherchant un lieu de résidence moins cher mais qualitatif.
Elle aura résorbé sa fracture interne et construit un espace urbain cohérent, avec un véritable centre commandant plusieurs niveaux de périphéries. Le centre historique, cœur de la ville et de l’agglomération, sera relayé par une zone fonctionnelle et commerciale péricentrale autour de la gare et par des quartiers résidentiels animés et ouverts sur le reste du territoire urbain.
Les équipements forts (comme les salles de spectacle) auront regagné le centre, qui se sera étoffé de commerces, restaurants, services privés, espaces publics, et qui aura vu sa population se diversifier largement par l’arrivée de jeunes ménages avec enfants, fréquentant l’offre urbaine du centre-ville.
Un pôle du réseau régional et pas le centre de la France
Châteauroux, grâce à son développement urbain, sera entrée dans le réseau urbain régional, ce qui lui permettra de faire des économies d’échelle en privilégiant l’urbanité relative. Il s’agit de se différencier du voisin pour jouer sur les complémentarités, au lieu d’essayer de tout concentrer en un seul lieu.
La ville ne se pensera plus au centre de la France, ce qui est une réalité géométrique mais pas une position forcément avantageuse. La centralité géométrique n’est pas toujours synonyme de centralité fonctionnelle, comme le montrent le cas du Massif Central et inversement celui de Paris et des métropoles françaises, toutes en périphérie du territoire national.
Elle aura, au contraire, trouvé sa place à plus petite échelle, dans le réseau urbain régional, ce qui représente une ambition plus modeste mais aussi plus vraisemblable et donc plus efficace. À son niveau, elle aura construit des relations productives avec Bourges, Poitiers et Orléans, pour mettre en œuvre un fonctionnement en archipel qui permettra aux habitants des différentes villes de profiter des aménités de chacune sans que les communes aient à financer de doublons.
Une telle organisation permettra à la ville de trouver une place dans le système urbain national, qui tend à la sélection par le vide pour se concentrer sur les espaces urbains les plus forts. Elle aura aussi l’avantage de jouer le rôle d’amortisseur contre les fluctuations des activités mondialisées, qui sont instables et mobiles et qui ne peuvent plus assurer à elles seules le développement d’une ville entière comme dans les années 1960-70.
La carte des principaux réseaux urbains du territoire français montre que ce dernier est constitué d’oasis urbaines et de nombreux déserts. Mis à part les métropoles et la capitale, formant un nœud majeur de densité à elles toutes seules, la seule solution pour se rattacher aux zones en développement urbain et ne pas tomber dans les déserts, est celle de faire partie d’un réseau de villes cumulant leurs potentiels urbains, pour faire masse et continuer à exister dans le paysage français.
Orientations stratégiques pour 2020
Continuité urbaine
L’un des principaux enjeux stratégiques pour Châteauroux est celui de résorber la coupure urbaine qui caractérise aujourd’hui la ville, ou plutôt les deux sous-villes qui la constituent. Il s’agit pour cela de développer l’espace situé au sud de la gare ferroviaire, qui présente pour l’instant un déficit d’urbanité tellement important qu’il joue le rôle de coupure entre les parties au nord et au sud de l’axe ferroviaire.
La seule liaison physique existant pour l’instant est la passerelle qui traverse les rails et à laquelle les habitants accordent beaucoup d’importance, souhaitant qu’elle soit mieux aménagée et mieux sécurisée. Dans ce contexte, il peut paraître surprenant que le conseil municipal ait voté la démolition de la passerelle, ne laissant ainsi qu’une liaison automobile nettement plus longue, qui contourne cet espace vide d’urbanité pour relier les autres quartiers de la ville et le centre historique.
Cette décision peut néanmoins contribuer à la construction d’une continuité urbaine si elle marque le début d’un travail plus global sur cet espace dans son ensemble, qui aurait alors pour ambition de l’urbaniser. Il s’agirait de l’intégrer dans le reste de la ville, plutôt que de se contenter d’en améliorer le franchissement, en continuant d’ignorer ce qui se passe en dessous de la passerelle.
Le quartier de la gare pourrait ainsi devenir un espace intermédiaire entre le centre-ville et les quartiers Saint-Jean et Saint-Jacques, qui fonctionnerait comme un nouvel espace urbain à part entière. Il aurait sa spécificité — probablement liée aux commerces et aux services tertiaires privés, voire à quelques bureaux profitant de la proximité de la gare — et son attractivité propres, tout en assurant la transition urbaine entre le centre-ville et les quartiers.
Hiérarchie
Il est également nécessaire de redessiner l’espace urbain castelroussin en introduisant une différenciation hiérarchique entre ce qui est pour l’instant une juxtaposition de quartiers, ayant un niveau d’urbanité uniformément bas. Plutôt que de disperser les équipements sur l’ensemble du territoire urbain, pour doter un peu chaque quartier et mettre de tout partout, il faut assumer le principe d’une centralité affirmée.
Dans une ville moyenne comme Châteauroux, le centre-ville, pour être attractif, se doit de concentrer la quasi totalité des équipements et services rares. Il doit présenter une forte densité de commerces, de bars et restaurants, d’espaces publics comme des places, des jardins, etc.. Il doit parvenir à dégager une ambiance urbaine, par la vitalité de sa fréquentation (densité de populations présentes, à toutes les heures) et par la qualité de son paysage, qui joue le rôle de vitrine pour la ville.
Le centre doit être en mesure de jouer le rôle de moteur d’impulsion pour le reste de la ville, tout comme celui de lieu principal de brassage des habitants, qu’ils résident à Châteauroux ou qu’ils fréquentent la ville pour des raisons spécifiques (emploi, accès à des services, achats, loisirs, etc.) Il est donc important qu’il bénéficie à la fois de lieux et d’événements qui favorisent un tel processus, à l’instar du marché du quartier Saint-Jean, rayonnant sur l’ensemble de la ville.
Face à ce centre bien affirmé, il faut éviter d’avoir uniquement des quartiers à fonction principalement résidentielle, qui présentent un niveau d’urbanité bas et qui seront donc en très net décalage avec le centre-ville. Un espace urbain qui fonctionne correctement nécessite la présence de zones péricentrales à niveau d’urbanité intermédiaire, qui fassent la transition avec le reste de la ville.
Dans cette optique de hiérarchisation la question se pose de la pertinence de la mise en place du système de bus gratuits circulant dans la ville. L’absence de coût, donc indirectement de valeur, du déplacement, tend à uniformiser les espaces comme s’ils se valaient tous. En termes de coûts de trajet, il est équivalent de rester dans son quartier ou d’aller au centre-ville ou encore d’aller dans un autre quartier. Une telle banalisation pourrait nuire à l’effort de hiérarchisation des espaces à conduire à Châteauroux.
Valoriser les différences
La hiérarchisation des niveaux d’urbanité dans la ville ne doit pas, pour autant, se traduire par une indifférenciation des quartiers, qui seraient noyés dans une masse uniforme en regard d’un centre particulièrement affirmé. Le principe de hiérarchisation, essentiellement quantitatif, n’est pas incompatible avec le maintien, voire la valorisation d’une différenciation qualitative.
Les quartiers de Châteauroux, présentant d’ores et déjà des spécificités notables, peuvent en jouer pour développer leur urbanité relative (par rapport au voisin) et conserver ainsi leur attractivité. Les habitants ont, par exemple, beaucoup insisté sur la forte mixité et ouverture internationale des quartiers Saint-Jean et Saint-Jacques, qui pourrait continuer de jouer le rôle de marqueur urbain pour ces espaces et préserver leur identité originale.
Si la ville bénéficie d’une centralité efficace, capable d’assurer la cohésion et le brassage des populations, la création — crainte par les habitants — d’un « quartier chinois » à l’occasion de l’ouverture de la zone franche franco-chinoise, ne représenterait pas forcément une menace de repli social et communautaire. Bien géré, ce quartier « ethnique » pourrait aussi apporter une touche de diversité et d’attractivité supplémentaire à la ville.
Totalité : identité et identification
Les échanges avec les habitants ont montré qu’ils ne se sentent pas appartenir à Châteauroux dans son ensemble, comme unité urbaine, mais éventuellement au quartier dans lequel ils résident. La ville manque visiblement d’un facteur de rassemblement autour d’une identité collective partagée par l’ensemble des habitants.
Il va donc s’agir pour Châteauroux d’identifier les lieux, les équipements, les objets patrimoniaux, aptes à fédérer la population locale autour de valeurs communes, et de les mettre en valeur en tant que tels. Les réunions avec les habitants ont notamment montré qu’ils s’identifiaient difficilement à la ville, faute d’une esthétique attractive et/ou d’un patrimoine historique remarquable.
Afin que cette totalité soit ressentie par les habitants, il est aussi indispensable que la ville se rende visible aux yeux de ces derniers. Pour cela, il faut qu’elle parvienne à dépasser le simple agencement spatial de bâti, d’équipements et d’activités pour générer ce supplément d’âme qu’est l’ambiance urbaine, dans laquelle les populations pourront se reconnaître.
Les différents participants, élus, professionnels et habitants, ont dessiné une ville en perte de vitesse, comme dépassée par les évolutions en cours. Une crise économique, des tensions sociales entre communautés, des fermetures et des départs, notamment de la population jeune, brossent un sombre tableau. Pourtant, Châteauroux ne manque ni de potentiel (situation de carrefour, offre urbaine), ni de motivation, notamment chez les habitants, pour orienter son développement vers plus de centralité et d’attractivité, donc vers plus de ville.
Le cap prospectif : négocier le virage de l’urbanisation.
Au vu des propos tenus par les deux groupes, Châteauroux présente à la fois des symptômes d’urbanisation – qui l’éloignent de son identité de centre rural – et des symptômes de manque d’urbanité – qui l’empêchent d’atteindre, pour l’instant, le statut de ville à part entière.
Bien que Châteauroux ait fondé son identité sur une distinction nette avec le modèle urbain métropolitain, au profit d’une proximité avec son environnement rural, pour lequel elle jouerait le rôle de centre d’échanges, elle semble avoir été rattrapée par l’urbanité. Le fait que Châteauroux soit devenu un pôle d’attractivité régional (pour les communes alentour et pour les étudiants de l’antenne universitaire) et même international, avec l’arrivée de migrants non européens et la future installation d’une zone franche franco-chinoise, a certainement induit une dynamique d’urbanisation.
Celle-ci se traduit notamment par l’apparition de véritables banlieues, très nettement distinctes du centre-ville (habitat social à l’architecture en barres ; éloignement géographique). Elle se lit également à travers la dynamique de périurbanisation résidentielle, décrite par l’ensemble des participants, qui est typique d’une croissance urbaine. Le niveau de l’offre urbaine, par exemple l’existence d’un cycle universitaire à bac + 3, mais aussi d’un festival de danse au rayonnement international, est également un moteur d’urbanisation, car il renforce l’attractivité et donc la centralité de Châteauroux vis-à-vis de son environnement.
On retrouve cette conscience d’un niveau d’urbanité croissant, dépassant largement la situation de gros centre rural, dans la vision des habitants. Le fait qu’ils se comparent spontanément aux banlieues parisiennes (pour montrer leur différence, certes) ou qu’ils identifient le building Gambetta comme un centre d’affaires du type de La Défense, montre qu’ils se réfèrent clairement au modèle urbain métropolitain. La capitale est même prise en exemple pour les relations sociales et les rapports entre communautés, dans la mesure où l’anonymat et « l’inattention civile » qui y règnent seraient enviés par certains participants.
Cependant, aux dires des deux groupes, Châteauroux présente aussi un réel déficit d’urbanité, qui se traduit notamment par l’atonie de son centre-ville. La faiblesse des prix du foncier, la gratuité des transports publics (créant paradoxalement une diminution de valeur des lieux ainsi desservis et donc une moindre reconnaissance de leadership spatial par la population), la fermeture des écoles et des commerces, le manque de diversité de l’offre urbaine centrale (peu de loisirs), l’absence de vie nocturne et le manque de débouchés induisant des départs croissants chez les jeunes populations, sont autant de lacunes qui privent Châteauroux des bénéfices de l’urbanisation en cours. Bien qu’elle grossisse et s’étoffe, la ville reste peu attractive, aussi bien pour l’extérieur (ménages sans enfants notamment) que pour ses habitants.
Châteauroux commence à présenter des dynamiques de clivage et de repli de ses différents quartiers, qui croissent séparément, sans capacité d’intégration globale. Dans ce contexte, la diversité des populations présentes tend à générer des tensions plutôt que de la mixité, qui pourraient aller en empirant. Châteauroux doit donc impérativement parvenir à maîtriser cette urbanisation en cours, pour en faire un atout de redynamisation, au lieu d’en subir les conséquences néfastes, comme c’est le cas pour l’instant.
La carte des ressources : exploiter les atouts de l’intérieur plutôt que la prédation des richesses externes.
Pour l’instant, la solution est conçue comme extérieure, sur le modèle du développement passé de la ville, grâce à la présence de la base de l’OTAN. Les espoirs fondés par l’ensemble des participants dans le rôle de carrefour logistique de Châteauroux et dans l’établissement de la zone franche franco-chinoise, illustre bien la conception de la ville comme comptoir de regroupement d’une richesse produite à l’extérieur (d’abord par les campagnes environnantes, puis par la base américaine, bientôt par la zone logistique chinoise).
Cependant, une telle solution est d’ores et déjà considérée avec circonspection par les habitants, conscients de sa fragilité et de son caractère peu durable pour le développement urbain de Châteauroux. Un des enjeux majeurs soulevés par les deux réunions semble donc être celui de la manière dont la ville saura trouver un équilibre nouveau, moins fondé sur des ressources externes que sur son potentiel interne.
Celui-ci passe notamment par le développement du centre-ville, pour atteindre la qualité de l’offre urbaine que l’on pourrait attendre d’une ville de cette taille et créer ainsi une dynamique d’attractivité intrinsèque. Les habitants ont, en effet, manifesté le besoin de pouvoir pratiquer un espace urbain offrant plus de diversité, aussi bien dans le brassage des communautés que dans l’offre de services. À tel point qu’ils recourent au réseau social Facebook, comme succédané d’agora. L’absence d’espaces publics, permettant la rencontre physique entre les habitants, au hasard des jours et des horaires, est partiellement et incomplètement compensée par les ressources des nouvelles technologies de la communication.
L’urbanité se fondant également sur la cohérence et l’articulation des différents quartiers composant la ville, le centre-ville se doit de rayonner et de commander les espaces limitrophes, tels les quartiers Saint-Jean et Saint-Jacques. Ces derniers sont, pour l’instant, assez autarciques, voire plus centraux que le centre-ville officiel aux yeux de leurs habitants. Il devient alors important de travailler les liaisons entre ces espaces, telles que la passerelle et plus généralement la zone intermédiaire entre ces deux pôles, bénéficiant déjà de l’atout de la gare ferroviaire.
Dans le cadre du cap prospectif ressorti des réunions précédentes – négocier le virage de l’urbanisation – les habitants ont fait émerger les obstacles potentiels à une telle dynamique, à savoir une centralité défaillante et une tendance au développement de bulles spatiales autonomes, voire concurrentes, et socialement clivées, ainsi que les principaux enjeux à prendre en compte : construire un espace urbain cohérent en hiérarchisant et reliant ses différents quartiers ; permettre aux habitants de se sentir appartenir à un ensemble commun.
Radar, les obstacles potentiels : un vide de centralité, un repli communautaire
Des pôles fonctionnels de plus en plus déconnectés ?
Dans le cadre de l’inévitable développement urbain de Châteauroux, le risque encouru par la ville, si la situation reste inchangée, est celui de la croissance de pôles déconnectés et concurrents, qui tendra à affaiblir la ville au lieu de favoriser son essor. Le centre-ville de Châteauroux souffre, en effet, de nombreuses lacunes en termes d’offre urbaine, mais aussi de qualité du bâti, ne lui permettant pas d’atteindre le niveau d’attractivité qui devrait être le sien pour commander l’avenir de la ville. En parallèle, les quartiers périphériques comme Saint-Jean et Saint-Jacques, ainsi que les espaces périurbains, connaissent une croissance de la population, symptomatique de la faiblesse du centre-ville.
Ce constat a été renforcé par la description de l’usage que les habitants font des différents pôles fonctionnels que l’on peut identifier à Châteauroux [Cap Sud, Equinoxe, Biocop], qui montre bien un usage ponctuel et dispersé des différentes ressources, sans que cela ne contribue à construire un sentiment d’appartenance collectif à un ensemble urbain cohérent. Les équipements utilisés dans la ville ou sa périphérie sont finalement sur le même plan que le magasin Ikea de Tours, illustrant ainsi le détachement fort existant entre la pratique des lieux par les habitants et leur investissement éventuel de la ville toute entière.
La question du manque d’un centre en mesure d’assurer l’agrégation de la population, de fonctionner comme une référence urbaine majeure et collective, a été décrite dans le détail lors des deux dernières réunions. Les habitants ont recouru à la comparaison avec des villes comme Paris et New York, pour exprimer le manque d’espaces publics, de lieux de rencontre et de vie, ouverts à l’ensemble de la population castelroussine. Des lieux où personnes ne se sentirait hors contexte ou mal à l’aise, comme c’est le cas actuellement pour les habitants de Saint-Jean et Saint-Jacques vis-à-vis du centre-ville, au sein duquel ils s’estiment mal acceptés.
Un risque de repli spatial et identitaire
La description par les habitants de la population, de ses interactions et de sa répartition montre une certaine divergence entre le discours d’intention, valorisant la diversité régnant dans les quartiers Saint-Jean et Saint-Jacques comme un facteur de rassemblement et d’attractivité [« Par rapport à l'homogénéité du centre-ville, Saint-Jean et Saint-Jacques sont véritablement mixtes. »], et la réalité des pratiques, qui montre davantage une juxtaposition de communautés qu’une véritable mixité [« Ici, sur le quartier, on a des bars communautaires. »].
La rencontre et le brassage restent difficiles à Châteauroux, alors qu’ils sont au principe même de la vie urbaine. La question se pose donc du risque d’un repli spatial et identitaire des différents quartiers, dynamique pouvant constituer un obstacle de taille. Un patchwork de communautés spatialement clivées, y compris la « bulle » chinoise en création, ne saurait favoriser l’essor de Châteauroux. La tendance des habitants à ne pas reconnaître la situation pour ce qu’elle est, et à en contourner les problèmes [« Les femmes d’ici vont dans les bars du centre-ville. »], contribue à maintenir le status quo.
Tableau de bord, les principaux enjeux d’avenir : hiérarchiser, relier, attacher
Hiérarchiser
Les différentes assertions des habitants ont fait ressortir un manque de gradation d’urbanité au sein de l’espace urbain castelroussin. Le centre-ville manque d’envergure et les quartiers immédiatement limitrophes comme Saint-Jean et Saint-Jacques, qui devraient avoir un niveau d’urbanité légèrement inférieur, semblent en fait être au même niveau, voire au-dessus de celui du centre-ville [« Saint-Jean est devenu le centre commercial des quartiers autour. » ]. Pourtant, les habitants de ces quartiers sont conscients du risque lié à un trop grand renforcement de ces derniers par rapport à un centre-ville apathique et aspirent au contraire à ce que la hiérarchie urbaine classique soit rétablie [« À Saint-Jean et Saint-Jacques il n’y a pas tellement de magasins, mais en même temps, s’il y en avait, cela se transformerait en ghetto. »].
Les habitants sont ainsi revenus sur l’importance de la passerelle reliant les quartiers Saint-Jean et Saint-Jacques au centre-ville, car elle présente visiblement un caractère stratégique insuffisamment exploité. Au-delà du lien matériel qu’elle représente déjà entre les deux espaces, elle a été envisagée comme la métonymie d’un espace intermédiaire pour l’instant négligé et qui mériterait d’être développé pour assurer la transition urbaine entre le centre et sa proche périphérie. Ainsi, ils ont insisté sur l’urgence de sa rénovation esthétique et de sa sécurisation nocturne, pour passer d’un simple équipement à un véritable quartier, appropriable par la population et prenant part à la structuration urbaine de la ville.
Relier
Les habitants ont exprimé la volonté de se rapprocher d’un fonctionnement urbain sur le modèle de certaines grandes villes ayant une forte identité, comme Paris ou New York, dans laquelle se retrouve l’ensemble de la population, au-delà des particularités de chaque quartier. Une manière de faire évoluer l’actuel voisinage distant entre quartiers et centre-ville vers une intégration spatiale et sociale qui fasse lien, matériellement et symboliquement « On pourrait faire un central park comme à New York, pour passer d’un truc à l’autre. ».
À une autre échelle, ils ont également mis l’accent sur l’importance d’établir des relations moins déséquilibrées avec les voisins plus ou moins proches, qui ne reposeraient plus seulement sur des flux centrifuges à partir de Châteauroux [« Entre Châteauroux et Limoges ou Poitiers il n’y a pas un voisinage réciproque. »] ou éventuellement des flux traversants la ville, sans s’y arrêter, mais dans une meilleure complémentarité relationnelle.
Attacher
La question du départ de la population, notamment les jeunes, semble inquiéter beaucoup les habitants, surtout ceux qui ont connu la ville dans son âge d’or, au moment où la présence d’une base de l’OTAN attirait une population étrangère nombreuse et souvent renouvelée. Aujourd’hui, la ville est visiblement envisagée comme un repoussoir, qui non seulement n’attire plus mais ne parvient pas non plus à retenir la population déjà présente [« À Châteauroux, la gare fait partir les gens, c’est la ville dans l’autre sens. »].
Cependant, les habitants semblent très conscients du fait que l’attractivité recherchée doit s’incarner dans des choix stratégiques en phase avec la ville et ses capacités. Ils ont par exemple souligné le manque de pertinence spatiale, à leurs yeux, de certains projets ayant justement pour but d’attirer du monde dans la ville, comme la salle de spectacle du Tarmac perçue comme surdimensionnée. Dans la même veine, ils ont insisté sur le caractère inopérant de l’aéroport pour le développement de la ville, dont la centralité géographique ne suffirait pas en faire une plateforme centrale de mobilité à l’échelle nationale, ou sur la nécessité d’agréger les pôles d’attractivité plutôt que de les disperser [« Le CBD [Châteauroux Business District] pourrait se faire près du CapSud, là où il est, c’est absurde. »]. Une attractivité ne reposant donc pas forcément sur de grands projets mais davantage sur une mise en cohérence urbaine.
Réunion 1
Des élus et des professionnels attachés au modèle urbain castelroussin et aux valeurs régionales, à la recherche des moyens d'une relance économique, sur le modèle des années « OTAN ».Réunion 2
Un groupe d'habitants qui a exprimé une forte conscience du besoin de renouvellement et de relance de la ville, mais également du potentiel dont elle dispose déjà et des atouts que représentent les nouvelles technologies de la communication.Réunion 3
Le « tour de ville » réalisé avec les habitants lors de cette deuxième réunion a montré des logiques de fractionnement et de clivage, en termes spatiaux, sociaux et fonctionnels entre les différents quartiers. Pourtant, la population est visiblement en quête d'une dynamique de croissance urbaine globale pour la ville et d'événements ou de lieux fédérateurs, qui la sortent de son statut de petite ville de province et lui confèrent une plus grande attractivité.Réunion 4
Cette réunion a fait apparaître les difficultés qui se profilent à l'horizon du développement urbain de Châteauroux, menacé par la croissance de petite polarités concurrentes, faiblement intégrées, voire mal dimensionnées, qui nuisent à l'essor global de la ville. En termes de populations, la question d'un véritable brassage, au-delà de la juxtaposition de groupes, et de l'existence de lieux pour le favoriser, comme un centre-ville jouant pleinement son rôle de moteur urbain et de pôle intégrateur.Réunion 5
La dernière réunion avec les habitants a permis d'approfondir certains enjeux clés pour l'avenir de la ville : l'indispensable gain d'urbanité et le nécessaire travail de mise en relation spatiale et sociale. Les habitants des ZUS peinent à se reconnaître dans la ville et à trouver des espaces communs. Une situation d'exclusion aggravée par la juxtaposition de pôles là où devraient s'emboîter des espaces allant du centre à la périphérie. Enfin, derrière le miroir aux alouettes de la diversité positive se pose la question de la capacité de la ville à mettre en cohérence ses différentes populations.